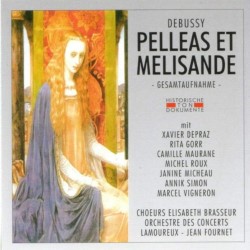Pelléas et Mélisande
Théâtre des Champs-Élysées • Paris • 09/05/2017|
Choeur de Radio France, chef de choeur Marc Korovitch
Orchestre National de France Louis Langrée (dm) Éric Ruf (ms,sc) Christian Lacroix (c) Bertrand Couderc (l) |
|

C'est un Pelléas superbe à tous points de vue que nous offre le théâtre des Champs-Élysées. Rarement une production aura été aussi cohérente et réussie.
Comme Stéphane Braunschweig (d'ailleurs présent ce soir) en 2014 à l'Opéra Comique, Éric Ruf signe à la fois la scénographie et la mise en scène. Comment en effet ne pas construire l'une pour l'autre, comment ne pas réfléchir à la structure qui accueille le drame, au changement ou à l'évolution du décor quand changent les scènes, et au sens symbolique que peut transmettre la scénographie ? Éric Ruf conduit à son terme l'idée du lieu unique, central et circulaire. Ce centre est tour à tour fontaine, grotte, souterrains, jusqu'à devenir la chambre mortuaire de Mélisande, dont le lit posé sur l'eau rappelle la scénographie entièrement aquatique qui soutenait la mise en scène de Pierre Médecin à l'Opéra Comique en 1998. C'est aussi autour d'un cercle que Robert Wilson refera tourner Golaud et Pelléas à l'Opéra de Paris à la rentrée. Stéphane Lissner s'est d'ailleurs déplacé ce soir. Ici-même, Hans Schavernoch concevait déjà un plan incliné central pour Martinoty en 2007, et Pelléas et Mélisande se retrouvaient aussi sur un étrange disque vert chez Braunschweig (également présent ce soir) en 2010 et 2014 à l'Opéra Comique, sous la direction de Gardiner puis de Louis Langrée.
Ce soir, des parois de noir métal, inspirées par la base de sous-marins de Lorient, enserrent plus ou moins ce disque central. La fenêtre de Mélisande s'y ouvre, des barreaux d'échelle y sont scellés, deux ouvertures y sont ménagées. On ne découvre ces éléments qu'au fur et à mesure des besoins, quand la lumière les touche, quand une porte s'ouvre. Malgré la complexité de cette structure, la sobriété souhaitable est ainsi préservée. De chaque côté de l'avant-scène, une passerelle enrichit l'espace de jeu. La scène et les lumières sont noires comme plusieurs fois déjà cette saison, ainsi dans l'exemplaire Fantasio produit par l'Opéra Comique au Châtelet. Plus décoratif, un filet est parfois suspendu à mi-hauteur au-dessus du disque central. Comme l'écrit fort poétiquement Éric Ruf, c'est un décor à marée basse, envasé, qui porte l'angoisse des mortes eaux et où se meuvent lentement les poissons aveugles des grands fonds. Cette vision est parfaitement compatible avec le symbolisme pictural comme avec celui de Maeterlinck. La lenteur imprègne tout le jeu des acteurs et évacue la psychologie en la condensant dans des poses préraphaélites, des silhouettes de muses antiques rêvées par Maurice Denis - auteur de la coupole autrement plus lumineuse du théâtre.

Noirs aussi les superbes costumes de Christian Lacroix. Blanche dans la forêt puis sur son lit de mort, Mélisande se drape aussi de noir dès son intégration au royaume d'Allemonde. Aucune rébellion, aucune critique sociale, tout est accepté, tout coule de source. Pelléas et Mélisande sont là, face à face et face à leur destin. Ils ne semblent pas se poser de questions, ni d'abord exprimer leurs sentiments autrement que par des regards, attitudes et gestes très mesurés. Au fil du temps, chaque approche ou chaque contact semble déclencher un orage, comme si les personnages étaient aimantés positivement ou négativement.
« Les répétitions sont là pour épuiser toute psychologie, tout volontarisme et aboutir à la belle et simple réalité des situations. (...) Le corps du chanteur ou de l'acteur doit "parler" quand le texte fait défaut. (...) Il faut densifier chaque parole, chaque pas, chaque geste et les rendre rares. », écrit Éric Ruf. Comme Debussy cherchant « celui qui, disant les choses à demi, me permettra de greffer mon rêve sur le sien », Éric Ruf laisse au spectateur l'espace de liberté qui lui permet de rêver.
Loin du réalisme bourgeois de Martinoty en 2007 ou de l'onirisme bourgeois de Médecin en 1998, Éric Ruf est plus proche ce soir de la justesse dramatique de Braunschweig en 2014. Même s'il pousse à bout la force de l'immobilité, il réussit à enrichir le sens sans perdre la justesse. Si cette démarche croise parfois celle de Bob Wilson, on sent cependant le chemin totalement différent qui l'a conduite. Il est étonnant de constater qu'au fil des relectures par des metteurs en scène contemporains, un auteur comme Maeterlinck, considéré jadis comme le comble de l'artifice, semble de plus en plus naturel ! Un peu comme longtemps après, revoir un film de Bresson ou Rohmer peut bouleverser de justesse, alors qu'on y avait vu jadis un irritant exercice de style.
Le décor étant quasi unique, l'enchaînement des scènes est ce soir très réussi. Ce n'est qu'avant le dernier acte que l'installation du lit de Mélisande prend un temps excessif, au cours duquel les lumières de la salle sont stupidement à moitié rallumées. Comme l'a voulu Éric Ruf, les personnages sont immobiles et le monde tourne autour d'eux. Chacun développe une présence corporelle spécifique, mais sans aller jusqu'aux tics habituels de l'adolescent ou du grand-père. Kyle Ketelsen en particulier développe une raideur monolithique toute néanderthalienne, jusqu'à se voûter et sembler porter un corset dans sa scène de l'épée. Vocalement, on ne peut lui reprocher que quelques "a" bâillés en "â", quelques "è" neutralisés en "eu" ouverts, et de ne pas chanter piano son imploration "Mélisande, as-tu pitié de moi..." du dernier acte.
Jean Teitgen est un bel Arkel, dont la justesse n'est douteuse qu'au premier acte. Simple et direct, sans les défauts d'une voix vieillie, il offre une interprétation décantée et paisible d'un personnage souvent énervant et pontifiant. Son air de l'acte IV scène II est superbe. Habituée du rôle de Geneviève, Sylvie Brunet est surtout une stature, voire une statue de diva, prêtresse antique drapée de noire, Sarah Bernhardt ou George Sand hyper-romantique. Vocalement, sa déclamation est un peu hachée, mais elle déploie une inhabituelle palette de nuances. Comme presque tous les Yniold, Jennifer Courcier est délicieuse, scéniquement comme vocalement.
Dans ce cadre et avec la maturité, Jean-Sébastien Bou assagit sa vaillance habituelle. Ses aigus "tirent" davantage, mais Debussy lui-même le souhaitait presque ! Contrairement à Kyle Ketelsen, Jean-Sébastien Bou apporte son absolue maîtrise du rôle : ayant assimilé depuis longtemps chacune des nuances rythmiques écrites par Debussy, il restitue comme en improvisant la prosodie que Debussy a souhaité ainsi transcrire.
Quant à Patricia Petibon, c'est la Mélisande idéale tant vocalement que scéniquement. On découvre grâce à elle que ce rôle est vraiment écrit et peut être vraiment chanté, que son personnage existe déjà, sans qu'une inconsistance supposée n'oblige à le tirer vers tel ou tel fantasme personnel. Elle est bien sûr aidée par l'atmosphère que crée le décor, par l'extension prodigieuse de ses cheveux idéalement roux, par la lumière dorée de la fenêtre ouverte où elle apparaît comme une princesse de conte, comme une enluminure de livre d'heures, comme une icône revêtue de métal repoussé. à la fin de la scène, Mélisande retrouve son immobilité d'icône et sa fenêtre se referme comme un livre d'images.
Belle image aussi de Pelléas et Mélisande marchant en s'équilibrant de leurs bras tendus sur les dalles de rochers émergeant de l'eau. Déception par contre de voir Golaud et Pelléas planter sur scène un arbre mort en sortant des souterrains, à seule fin qu'Yniold puisse y grimper pour espionner Mélisande dans la scène suivante. Sur son "Viens !", Golaud sort seul et Yniold doit descendre de son arbre et le rejoindre. Autre choix de temps, dans la scène d'Absalon, Arkel intervient avant son exclamation "Golaud !", ce qui réduit d'autant la gêne habituellement ressentie à sa passivité pendant cette scène.
Dans la mare désormais dépourvue de rochers, Yniold fait flotter des bateaux en papier. Ce seront bien sûr les moutons. Yniold fait mine de dire la réplique du berger, qui est donc chantée hors scène. Sur scène, le même Arnaud Richard incarne ensuite un médecin habillé en sombre matelot au bonnet noir.
Trois Parques-servantes, médiévales damoiselles, traversent régulièrement la scène. Elles figurent naturellement les trois vieux pauvres de la grotte puis les servantes envahissant la chambre du dernier acte.
Dirigé par Louis Langrée, l'Orchestre National de France retrouve les belles couleurs françaises de son enregistrement de 2000 ici-même.
À voir jusqu'au 17 mai au Théâtre des Champs-Élysées. à écouter sur France-Musique le dimanche 4 juin 2017 à 20h.
Alain Zürcher