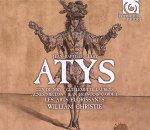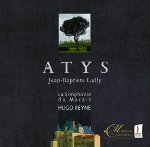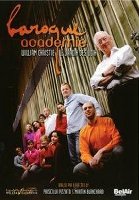Atys
Opéra Comique • Paris • 13/05/2011|
Compagnie Fêtes galantes
Choeur et orchestre des Arts Florissants William Christie (dm) Jean-Marie Villégier (ms) Francine Lancelot † et Béatrice Massin (chg) Carlo Tommasi (d) Patrice Cauchetier (c) Patrick Méeüs (l) Daniel Blanc (perruques) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Après avoir été sacré spectacle "mythique" et "origine du renouveau de l'opéra baroque en France", la production d'Atys de 1986-87 connaît une nouvelle consécration, fort rare au théâtre : sa recréation 24 ans plus tard ! Elle ne bat cependant pas le record des Noces de Figaro de Strehler, créées en 1973 et encore reprises cette saison. Les décors détruits ayant dû être reconstruits et les costumes restaurés, ce spectacle n'a pu être remonté que grâce à un mécène américain qui a voulu le revoir avant de mourir.
Dans la fosse, nous trouvons un chef et un orchestre en pleine forme, au son plutôt plus plein, aux phrasés plus toniques, dans une architecture d'ensemble encore clarifiée. Le continuo sonne plus riche et plus souple, les trémolos de cordes graves accompagnant le sinistre Alecton sont plus expressifs et glaçants. Toute l'oeuvre a gagné en évidence. Elle avait séduit par son "authenticité", elle emporte maintenant par sa modernité. Tout perruqués qu'ils sont, ses personnages s'expriment de la manière la plus sincère et directe qui soit, ce sont les Feux de l'Amour du XVIIe siècle ! La mythologie n'est ici qu'un voile de pure convention, aucun personnage ne fait preuve du moindre héroïsme, à se demander même comment Atys a pu être considéré comme "l'opéra du roi", dont Louis XIV aurait suivi et inspiré la genèse, alors que sa morale pourrait être que l'amour sincère entre deux êtres est toujours écrasé par le pouvoir royal ou divin !
Grâce aux nombreuses scènes qui se passent dans l'intimité, l'expression privée a en effet toute sa place. Comme dans une tragédie de Racine, on dit tout à son confident. Jean-Marie Villégier renforce cette intimité en faisant arriver au dernier moment, et ressortir aussitôt, les personnages subalternes qui ont une réplique à dire. Ces passages de personnages apportent d'ailleurs un élément presque comique, une distanciation subtile. Car gestuelle, déplacements, costumes et perruques n'ont aucune estampille d'"authenticité", et la fascination qu'a exercé ce spectacle en 1987 résulte en partie d'un malentendu ! Des perruques aussi délirantes n'ont jamais été portées, et tout le monde ne se déplaçait peut-être pas en permanence en arrondissant le coude et en levant deux doigts ! Quelques sources d'époque ont effectivement inspiré décors et costumes, mais amplifiées à l'extrême et hors contexte, pour correspondre au fantasme d'un deuil perpétuel du metteur en scène et du décorateur. Fort de ce succès, ils avaient d'ailleurs poursuivi dans la même veine avec en 93 une Médée de Charpentier encore plus dorée, capiteuse et hiératique.
Par contraste, le prologue est pastel et champêtre. à la fin de celui-ci, les tapisseries qui ornent les murs du plateau nu tombent pour découvrir les marbres noirs et gris qui constitueront le décor unique des cinq actes de la tragédie. C'est un tour de force d'avoir réussi dès 87 à captiver l'attention pendant trois heures avec une oeuvre inconnue présentée dans un décor unique - une boîte cubique et quasiment vide ! Si à l'époque, le phénomène Atys m'avait semblé la récupération mondaine quelque peu irritante d'un processus de redécouverte du répertoire baroque déjà bien amorcé par Malgoire, Herreweghe, Gardiner et Christie lui-même, il faut avouer que tout convergeait pour faire de cette production un spectacle captivant : le choix de l'oeuvre, l'intelligence de la mise en scène, l'impact esthétique des décors et des costumes, l'intégration parfaite de la danse... Autant d'éléments qui n'ont étonnamment pas vieilli ! Quant aux chanteurs et musiciens, s'ils étaient bien choisis, on les avait cependant déjà entendus ailleurs.
La distribution vocale de ce soir n'a rien à envier à celle d'origine, et encore moins à celle de la reprise un peu tiède et usée de 92 ! On remarque une meilleure longévité des voix masculines graves, puisque Bernard Deletré et Nicolas Rivenq chantaient déjà leurs rôles il y a 24 ans, mais tous les autres font partie d'une nouvelle génération. On peut louer leur diction encore améliorée du français. En 1987, le niveau moyen de respect de l'articulation de la langue française sur les scènes lyriques était abominable, et les "baroqueux" se faisaient presque critiquer de chercher à se faire comprendre ! On ne se gênait pas pour insinuer qu'ayant des voix si claires et fluettes, c'était bien le moins qu'ils puissent articuler, puisqu'ils ne faisaient guère en somme que parler, et non véritablement chanter avec de vraies voix lyriques... Vingt-quatre ans plus tard, ce sont eux qui ont fait évoluer la norme, et ce sont les voix grossies, ampoulées, tubées, ululées, en bouillie, forcées et déformées de toute manière qui se font huer et reléguer dans un poussiéreux passé !
Dans les petits rôles, on peut apprécier la fraîcheur vocale de la promotion 2011 du Jardin des Voix, cette académie fondée par William Christie en 2002. Marc Mauillon faisait d'ailleurs partie de cette première promotion, et Emmanuelle de Negri de celle de 2009 ! Il faut reconnaître à William Christie un immense sens de la transmission, dont on constate le succès en suivant les carrières de ceux qui ont débuté avec lui. Même s'ils ne se gênent souvent pas pour critiquer son tempérament et démonter le fonctionnement d'un certain système, nulle part ailleurs autant de choristes ne sont devenus solistes et autant d'instrumentistes ne sont devenus chefs d'orchestre !
Au crédit de William Christie, on peut aussi inscrire ce soir une parfaite coordination entre la fosse et le plateau, même quand y jouent les musiciens de la scène du sommeil.

Au début du quatrième acte, Lully, après avoir "inventé" le récitatif français, semble "inventer" la polyphonie en faisant peu à peu émerger le trio de Sangaride, Doris et Idas du quasi-unisson dans lequel Doris et Idas s'expriment d'abord. La scène de ménage entre Atys et Sangaride est ensuite très simplement mais efficacement écrite. Tout s'achemine vers la catastrophe finale, habituelle au théâtre mais étonnante pour l'époque sur une scène lyrique.
Déjà apprécié à Freiburg en 2006 en Idomeneo et en 2008 en Lucio Silla, ainsi qu'ici-même en Alphonse de Zampa, Bernard Richter tient le rôle titre avec une facilité et un naturel confondants. Il est difficile de croire, à l'entendre, que ces rôles de haute-contre aient été considérés comme tendus, difficiles à chanter et à conserver intelligibles dans l'aigu ! Nulle trace chez lui de la nasalité qui a affecté tant de prétendants à ce répertoire. S'il n'a pas la pure poésie de Guy de Mey, sa palette d'inflexions en force comme en douceur est remarquable, comme son talent à sculpter et savourer les mots.
Son port et sa démarche sont d'une noblesse certes étudiée mais tout-à-fait réussie, alors qu'Emmanuelle de Negri, superbe Sangaride par ailleurs, monte et descend sur ses pieds comme une paysanne quand elle arpente la scène en proie à l'agitation. Stéphanie d'Oustrac aussi est admirable de démarche, tandis que Jaël Azzaretti et Nicolas Rivenq se déplacent de manière beaucoup plus heurtée. On se demande jusqu'à quel point ces différences ont été travaillées avec Jean-Marie Villégier, qui n'est certainement pas homme à laisser le hasard ou l'habitude intervenir dans une matière aussi cruciale.
Marc Mauillon déçoit un peu en rendant sa voix trop nasale, dans un rôle sans doute trop grave pour lui. On comprend qu'une touche de cette couleur serve à caractériser le côté bouffe de son personnage, de même que l'acidité de la voix de Jaël Azzaretti est acceptable en Mélisse, mais point trop n'en faut. Cyril Auvity est mordant comme à l'accoutumée, ce qui n'est peut-être pas la caractéristique première que l'on attend de Morphée, mais cela contraste bien avec les doucereuses paroles de Paul Agnew. Nicolas Rivenq commence avec une émission un peu cravatée et hachée mais se reprend vite. Bernard Deletré, en parfaite forme vocale, caractérise aussi bien le noble Temps qu'un truculent Sangar, fleuve à qui l'eau répugne.
Stéphanie d'Oustrac fait craindre le pire à son entrée, mais nous donne finalement le meilleur. Difficile sans doute de se "chauffer" pour quelques lignes, quand on doit ensuite tenir la scène par-delà deux entractes, jusqu'au terme de l'oeuvre. La tessiture du rôle ne semble d'abord pas lui convenir, jusqu'à qu'elle centre sa voix avec plus de simplicité en dialoguant avec Mélisse. Peut-être pourrait-elle mieux concentrer Espoir si cher et si doux, qu'elle chante un peu large en bouche et rend ainsi inégal. Cet air semble avoir directement inspiré le Cruelle mère des Amours de Rameau ! Son tempérament de tragédienne ne lui laisse ensuite plus lâcher son personnage ni sa voix avant le rideau final.
À voir jusqu'au 21 mai à l'Opéra Comique, puis à Caen, Bordeaux et Versailles. à voir en direct le 21 mai sur Mezzo, à écouter le 4 juin à 19h sur France-Musique.
Alain Zürcher